
En quoi le concert du 14 décembre à l’Auditorium de Lyon est-il vraiment une Carte Blanche ?
Parce que j’ai pu programmer ce que je souhaitais. D’abord, j’ai eu envie de faire ce duo avec Michel. Ça fait 30 ans qu’on joue ensemble : notre premier duo remonte au festival de Grenoble en 1981 même si on avait déjà joué ensemble auparavant. Puis, on s’est retrouvé toutes ces années. C’est quelqu’un avec qui j’ai des rapports musicaux depuis longtemps, pas forcément fréquents mais réguliers.
On s’est en effet toujours retrouvé, soit dans des formations, soit en duo. On passe pas mal de temps aussi à discuter ensemble de la musique, notamment avant les concerts pour savoir où l’on en est. Tous les deux, ce n’est pas qu’un parcours musical. C’est aussi un parcours de réflexion.
Est-ce une difficulté de jouer des mêmes instruments ?
Non. C’est une histoire de personnalités, de savoir si l’on a des personnalités qui s’accordent. Après ça peut être n’importe quel instrument : si on a des envies communes, des points de convergence assez forts, l’instrument est secondaire. L’important est ailleurs, savoir si l’on est dans le même esprit, si l’on a une même idée de la musique, si l’on a des choses à partager.
Avec Michel, on s’est rencontré dans plein d’occasions différentes, et en même temps nos parcours sont distincts. Chaque fois qu’on se voit, on essaie d’inventer à partir de nos compositions. Il compose depuis longtemps, moi aussi.
Du coup, on dispose d’un matériau assez vaste. En fonction du lieu, de son acoustique ou de sa taille, on décide des compositions qu’on va utiliser et comment on va les jouer car on ne les joue jamais de la même manière.
Qu’en est-il lorsqu’on joue à l’Auditorium où vous avez déjà joué par le passé ?
Depuis qu’ils ont retravaillé l’acoustique c’est beaucoup mieux mais c’est un endroit où il faut prendre le parti de jouer presque acoustique. J’ai peu de souvenirs mais j’y avais joué en duo avec Michel il y a une quinzaine d’années, on se sentait très bien.
Quant au public, on ne le sent pas si loin que ça. C’est comme Vienne : c’est un lieu immense mais on se sent proche du public.
Comme vous, Michel Portal multiplie les va et vient entre jazz et musique classique ?
C ‘est ce qui est intéressant dans cette musique, c’est que c’est une musique ouverte, un territoire ouvert, qui nous amène à travailler aussi bien avec des musiciens de musique contemporaine qu’avec des musiciens baroques, avec des photographes, des danseurs, des gens de théâtre ou de cinéma, c’est à dire que quand on est jazzman on est à la fois musicien, compositeur, instrumentiste, chef d’orchestre. Ce qui fait qu’on est toujours à se confronter à des disciplines différentes, à des expériences nouvelles.
Vous jouez tous deux des mêmes instruments, dont la clarinette et la clarinette basse. Jugez-vous comme certains que cet instrument le parent pauvre du jazz ?
D’une part, c’est celui avec lequel j’exprime ma musique, c’est donc plutôt un parent riche. Mais, quand on voit tout ce qui s’est fait en clarinette en Nouvelle Orléans, tout ce qui s’est fait de Duke Ellington, jusqu’à Jimmy Giuffre, je ne pense pas que ce soit vraiment le parent pauvre. Au contraire, il y a une place de la clarinette dans le jazz qui est assez conséquente.
Et concernant ces dernières années, estimez-vous que cette place grandit ?
Au cours des dernières années, il y a nous c’est déjà pas mal. Mais en Europe, depuis une trentaine ou une quarantaine d’années, il y a une école de clarinette qui est très forte : en Italie, en Angleterre en Allemagne et notamment en France.
Ici, il y a une école de clarinette qui s’est extrêmement développée avec de grands professeurs et avec des compositeurs comme Boulez qui ont fait beaucoup pour faire évoluer cet instrument.
En musique contemporaine, on a de grandes œuvres et depuis les années 50 jusqu’à aujourd’hui, s’est développé tout un répertoire extrêmement riche. De même pour la clarinette basse : depuis une trentaine d’années c’est un instrument qui est de plus en plus utilisé.
Revenons aux musiciens qui seront autour de vous ce soir là et cette rencontre avec Keyvan Chemirani. Quelle en est l’origine ?
J’aime beaucoup travailler assez longtemps avec les mêmes musiciens car existe un rapport de confiance, une complicité qui s’affine, qui se complexifie. J’avais monté un précédent trio qui s’appelait Atlas Trio avec Gilles Coronado à la guitare et Benjamin Moussay aux claviers.
On a fait un premier projet, on a enregistré un disque chez ECM (ça fait 25 ans que je fais tous mes disques chez ECM). Je voulais continuer ce travail avec ces musiciens mais sur un nouveau projet et puis j’avais par ailleurs depuis une dizaine d’années envie de travailler avec Keyvan Chemirani mais je n’avais pas trouvé le contexte juste et là, j’ai pensé que l’association de mon trio avec Keyvan Chemirani ça allait permettre un nouvel univers. Donc j’ai créé un nouvel orchestre, un nouveau répertoire spécifiquement pour cette formation. Mais Keyvan Chemirani qui joue dans la tradition du zarb et du tar a influencé ma façon d’écrire. C’est l’instrument de percussion traditionnel iranien, ça n’a donc pas du tout la puissance d’une batterie.
Ça n’emmène pas la musique dans la même direction. Mais dans une direction très particulière. Je n’aurais pas écris de la même manière si j’avais écris pour un batteur. J’ai fait ce projet aussi en pensant énormément à la mélodie car j’ai toujours composé beaucoup de mélodies. Même si par moment je peux faire des musiques très abstraites, très contemporaines , atonales etc… j’ai toujours besoin de mélodies et chaque fois que j’ai un projet je compose presque des chansons .
J’aime beaucoup les composer, j’aime beaucoup les jouer. Et sur ce projet je voulais vraiment enfoncer le clou sur la mélodie c’est pour ça que j’ai appelé le projet « Silk and Salt mélodies ».
Vous vous êtes promenés à peu près partout à travers le monde et les continents et à chaque fois vous trouvez quelque chose qui va nourrir votre musique…
Oui, mais ce n’est pas aussi direct que ça. Je ne m’inspirerais pas directement d’une musique vietnamienne par exemple, ce serait assez anecdotique. Il faut que ça prenne beaucoup de temps sinon ce serait de l’influence directe, trop immédiate et on tombe dans l’imitation, sans plus. J’entends des choses mais ça va mûrir peut-être dix ans, vingt ans avant que ça ressorte,…….si ça ressort d’ailleurs. Je me méfie des emprunts trop immédiats ou trop directs à d’autres cultures. Ça reste souvent un exercice de style. On peut faire ça quand on fait des musiques de cinéma : on peut s’amuser à faire des exercices de style en fonction du film, de ce qui est demandé. Mais pour développer mes propres choses il faut que je m’éloigne.
L’inspiration est-elle toujours aussi évidente au fil des années ?
L’inspiration est une chose de très simple. C’est se lever le matin et puis de travailler de 8 heures-midi, 2 heures – 6 heures, en étant régulier…..régulier. Tous les jours. Parce que l’inspiration ça n’existe pas, il faut simplement se mettre à la table et travailler.
On passe des journées à griffonner des choses jusqu’à ce qu’il y ait un fil qu’on arrive à saisir et à tirer. Mais c’est essentiellement du temps à passer.
L’inspiration on ne sait pas, on essaie simplement d’avoir des gestes, des mouvements, des moteurs, et puis à un moment donné il y a un geste qu’on arrive à saisir et tout va se greffer dessus. Mais je vous le répète c’est d’abord d’être régulier, régulier tous les jours.
En quoi la scène vous est-elle indispensable ?
La scène c’est tout, c’est ce dont on a besoin, c’est là où ça se passe, c’est là où ça compte, là où il y a le public, c’est là où la musique se réinvente, se compose sans fin, se développe. Le concert c’est tout. Tout joue : l’acoustique de la salle, la façon dont le public écoute, ça influe sur notre façon de jouer et donc sur notre musique.
Dans vos projets, anciens comme actuels, y-a-t-il des moteurs principaux ?
Dans la mesure où je travaille la composition depuis 40 ans on peut penser d’abord que j’ai une musique. Et ce qui m’intéresse c’est de composer des musiques que j’ai envie de jouer avec mon instrument, des musiques où je puisse exploiter mon instrument, où je peux improviser. Une composition qui est juste belle en soi mais qui ne permet pas une exploitation par l’improvisation ne sert à rien. Mais parmi les moteurs dont vous parlez, il y a surtout les musiciens avec lesquels je joue. L’inspiration principale, c‘est quand je constitue une ensemble, un groupe : je réunis des gens avec qui j’ai envie de jouer et je compose par rapport à eux, par rapport à ce que j’ai envie de les entendre faire par rapport à ce que je pense qu’ils vont apporter.
J’ai aussi envie de leur faire plaisir : quand on compose, on a d’abord envie de faire plaisir aux musiciens, de leur donner quelque chose, de leur donner une place importante, de leur donner aussi la possibilité d’apporter leur propre personnalité, leurs propres idées parce que finalement cette musique, même si au départ on est leader ou compositeur, à l’arrivée c’est un travail collectif.
Oui, l’inspiration première ce sont les musiciens, le collectif. Ce n’est pas l’instrument qui prime encore une fois c’est plutôt la personnalité du musicien. L’inspiration c’est beaucoup ça. Le reste, les formes que ça prend ne sont qu’anecdotiques.
De quelle façon les tensions de la société, violences ou autres, influent-elles sur votre jeu ?
Nous sommes inscrits dans la société. Nous musiciens de jazz, nous sommes en prise directe avec la réalité, ne serait-ce que pour des raisons économiques.
Dès qu’il y a moins d’argent ça arrive d’abord dans la culture. On est donc en prise très directe avec les réalités matérielles comme politiques. On est peut-être même beaucoup plus ancré dans le réel dans nos métiers car quand on est jazzman on est tout, on est aussi promoteur, agent, tourneur.
Par ailleurs, j’ai toujours joué dans des lieux très différents, que ce soit des entreprises, des hôpitaux, et on est souvent demandé pour aller faire des interventions ; peut-être pas toujours des concerts mais des rencontres, des discussions. La musique qui va à la rencontre des gens aujourd’hui c’est quelque chose d’acquis même si ce n’est pas toujours possible pour des raisons de budget ou d’autorisations.
Quant aux projets en cours : êtes-vous tenté de partir dans de nouvelles directions musicales ?
Maintenant, ce qui m’intéresse ce sont les rencontres. Chaque nouveau projet naît d’un désir particulier de jouer avec un tel ou un tel. Je passe mon temps évidemment à rencontrer des musiciens, des artistes, et il y a toujours un moment où je me dis « tiens voilà quelqu’un avec qui j’aimerais faire quelque chose et là, le projet naît. Ce n’est jamais l’inverse : « j’ai un projet et je vais chercher les musiciens ».
Là, je viens de monter un nouveau groupe à l’occasion de l’anniversaire du festival de Strasbourg . On m’a demandé de faire un projet spécial, donc j’ai monté un orchestre avec des musiciens africains. Et là, j’ai monté un projet musical qui est plutôt assez » jazz » par rapport à d’autres projets que j’ai pu faire car j’avais envie un peu de choses à la Mingus : j’avais envie de brasser un peu de cette manière là la musique, dans le principe d’avoir cette sorte de retour entre le parfait et l’imparfait, le propre et le sale, sans arrêt comme ça.
C’est quelque chose d’assez significatif chez Mingus, ces choses qui ont l’air d’être faites n’importe comment avant qu’on s’aperçoive que c’est en fait très rigoureux
En fait aujourd’hui, j’ai quatre ou cinq projets que je mène de front : Silk and Salt, ce quintette , le projet avec Amarillis , un duo avec Benjamin Moussay, beaucoup de duos avec différents musiciens et puis un ciné-concert. Donc pour l’instant, je ne suis pas en recherche de nouveautés mais ça viendra.
A Vaulx-en-Velin, il y a quelques années, vous aviez joué sur des images de film. Cette image filmée suscite-t-elle toujours la musique ?
Oui parfois mais pas tout le temps. Notamment dans les documentaires. Là, j’ai fait plusieurs documentaires sur Nicky de Saint-Phalle ou Tinguely et là, la musique vient très vite. Je travaille aussi avec Ernest Pignon-Ernest. Lui avait fait tout un projet de collage de ses œuvres à Naples qui est magnifique et j’ai fait un travail musical uniquement sur ce travail là. Ça s’appelle Napoli’s Walls. C’est un projet qu’on a beaucoup joué avec un tout dernier concert à Naples. Là j’ai dit c’est parfait, on arrête là.
Alors qu’on peut penser que de nombreuses correspondances existent entre Peinture et Musique, les musiciens sont-ils tentés de jouer à partir d’un travail plastique ?
Ce sont deux actes très différents. La peinture est un travail de solitaire qui est fait pour rester, alors que la musique est un travail collectif qui disparaît au moment où c’est joué. Deux mondes très différents. Après il peut y avoir des relations mais ce sont des relations qu’on va vouloir : à un moment, je vais me dire Soulages j’aime bien son travail et je vais faire une musique qui partirait de ça mais c’est pas évident.
A une époque j’avais fait une composition sur un peintre, mais il ne s’agissait pas d’illustrer la peinture mais simplement de s’imprégner d’une certaine atmosphère, d’un certain mouvement. Je le répète : ce sont quand même des mondes très distincts. On peut les associer jusqu’à un certain point mais faire des parallèles reste assez délicat. Ça tourne vite court finalement.
Quant à la création musicale aujourd’hui, comment expliquer le contraste entre sa vitalité et sa difficulté à se faire reconnaître comme telle, sauf dans quelques clubs ?
Dans notre domaine, qui est entre le jazz et l’inconnu, il y a énormément de choses toutes générations confondues : il y a beaucoup de jeunes musiciens de très, très bon niveau, une grosse culture musicale et beaucoup, beaucoup de projets très variés.
Oui, il y a un éventail très large de projets qui sont en général bien foutus. Je suis enthousiaste sur ce qui se passe : il y a beaucoup de musiciens qui se mettent en collectifs qui font des projets en commun.
Seul problème : où toutes ces choses vont-elles aller dans la mesure où il y a de moins en moins de lieux pour montrer ça et de moins en moins d’argent ? Là il y a un vrai déficit de politique culturelle car, pour que ces choses là deviennent pérennes, il faut une implantation forte, il faut que les musiciens soient implantés le temps de créer. Aujourd’hui la politique culturelle, surtout celle des collectivités locales, va plutôt vers l’évènementiel. Ce sont des évènements qui coûtent très cher, superficiels et qui ont très peu d’intérêt.
Quand on dit qu’il n’y a pas d’argent c’est faux. Il y en a, mais il y a des choix à faire. En ce moment, le choix qui est fait c’est de mettre de l’argent dans des évènements dits « populaires ». Ça ne veut rien dire. C’est de la démagogie, qu’on soit à droite ou à gauche – et c’est ça qui est terrible – et en assignant les artistes non plus à être créatifs mais à des postes de pédagogues, d’animateurs sociaux alors que c’est à partir d’une création qu’on pourrait leur demander éventuellement de rayonner le mieux possible avec sa création.
De quoi a besoin la société et on l’a bien vu dans les évènements récents ? On a abandonné cette façon de voir l’art, alors que ça n’a jamais été aussi utile. Du côté du pouvoir politique, il y a une sévère remise en question à faire et il faut que les décideurs d’une façon générale se cultivent parce qu’on est dans une génération d’hommes politiques et de décideurs incultes.
On ne peut pas être dirigés par des gens qui ne sont pas cultivés. La médiocrité de beaucoup d’hommes politiques est patente. Il faudrait un travail de fond il faudrait qu’ils apprennent à lire à l’ENA ou qu’ils aillent voir une exposition. Ça devrait être obligatoire. Parce qu’après c’est nous qui payons cette inculture.
Pour se réconforter, on constate et ce n’est pas d’aujourd’hui que Lyon est entouré, presque encerclé par une myriade de festivals qui s’étalent en banlieue tout au long de l’année : Vaulx, Saint-Fons, Fareins, Vienne, le Rhino. Pourtant rien de ce type à Lyon : comment l’expliquez-vous ?
C’est important ces festivals là, parce que plus il y a d’endroits, plus il y a de public. Ce qui est dramatique c’est la ville de Lyon elle-même. Tout se fait en banlieue et la ville de Lyon n’a jamais rien fait pour cette musique. Et d’ailleurs, pour revenir au concert du 14 c’est très bien que Vienne vienne faire des choses en relation avec l’Auditorium.
Parce que c’est dire aussi que le jazz a sa place dans les grandes salles et pour un public large et nombreux. Pour une fois, on ne dit pas qu’on va commencer petit par la cave « machin », mais au contraire on affirme qu’aujourd’hui cette musique a droit de cité dans ces endroits-là et ça fonctionne. Il pourrait très bien y avoir une salle ou deux de musique à Lyon réservées à toutes les musiques.
Il pourrait y avoir une scène nationale à Lyon. Or, il n’y a rien de tout ça. Planchon c’est à Villeurbanne qu’il a pu avoir un outil de travail, Maréchal est parti, Martinelli est parti, nombre d’écrivains sont partis. De là à conclure que pour un artiste à Lyon, la seule façon de s’en sortir c’est de foutre le camp…





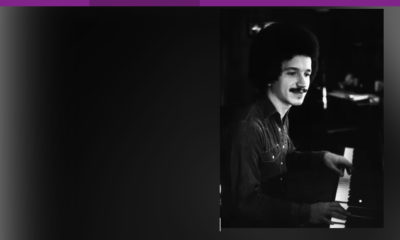

















Pingback: Sept concert Jazz au programme de l'Auditorium de Lyon